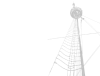La grande stratégie de Donald Trump (LV 264)
Animal politique, D. Trump a une vision stratégique, instinctive et articulée en trois directions. Avoir une stratégie ne signifie pas pourtant que vous savez bien la mettre en oeuvre.Que n’a-t-on pas dit sur Donald Trump : erratique, brouillon, grossier, inculte, velléitaire. Il est probablement tout cela, à mille lieux de l’image que nous nous faisons de l’homme d’État. Parler à son propos de grande stratégie paraît donc une gageure, une vue contre-intuitive en tout cas.
L’intuition et programme politique
Il ne manque pourtant pas d’intuition ni même de talent. Professionnel de l’image et du show (souvenez-vous quand il arriva à un meeting en camion poubelle, pour se moquer de J. Biden qui avait traité ses électeurs d’ordures), sentant instinctivement les attentes informulées de l’opinion, il est capable de tous les revirements. On n’est pas élu deux fois à la présidence des États-Unis si on n’a pas de talents.
Or, cette intuition est au service d’un véritable tempérament politique. Quelles que soient les foucades et les brusqueries, il a senti bien des attentes de son électorat. Observez d’ailleurs que si le reste du monde paraît effaré (du moins les dirigeants européens et chinois), D. Trump conserve une très bonne cote de popularité en Amérique. Sa politique étrangère dépend de sa politique intérieure.
Une grande stratégie, vraiment ?
Cette vision politique est profondément enracinée. Si Trump n’est pas un intellectuel, il arrive préparé à ce deuxième mandat. Il a ainsi écouté les uns et les autres et s’est entouré de personnes qu’il peut écouter, même s’il ne s’agit plus des adultes dans la pièce du premier mandat qui l’exaspéraient car il voyait en eux des obstacles à son intuition.
Au cours des quatre ans passés, il a donc construit une vision politique.
Tous les artisans de stratégie vous le diront, le processus a besoin de la vision initiale du décideur (LV 34, 35 et 153). Or, Trump est un décideur et il a une vision articulée autour de son slogan : Make America great again (MAGA). Il ne s’agit pas d’un simple slogan politique. Beaucoup de commentateurs, de ce côté-ci de l’Atlantique, s’en sont gaussés sans s’intéresser en profondeur à ce qu’il recouvrait.
Trump et ses électeurs ont un sentiment intimement enraciné qui leur dit que l’Amérique n’est pas aussi puissante qu’elle le pourrait et qu’elle est exploitée par le reste du monde, mais aussi qu’elle s’épuise à faire des choses dont elle n’a plus les moyens. Les politistes internationaux citeront ici l’historien Paul Kennedy et son « Naissance et déclin des grandes puissance » (1988) qui proposait le concept de surextension impériale. Trump estime que les rapports entre l’Amérique et le monde ne sont plus à l’avantage des États-Unis.
À l’international, cette vision s’appuie sur trois grandes orientations : un isolationnisme agressif ; le ciblage de la Chine ; le rejet de la mondialisation financière.
Isolationnisme agressif
Dans ce grand chamboulement, nous avions déjà pointé (LV 259) que M. Trump mettait l’Amérique au cœur de sa vision. Celle-ci est géographique : les États-Unis doivent dominer le continent américain, directement pour sa partie septentrionale, indirectement pour sa partir méridionale. Les premières déclarations sur les droits de douane avec ses deux voisins immédiats, Mexique et Canada, le ciblage du canal de Panama mais aussi l’idée d’incorporer le Canada ou encore le Groenland montrent une perception géographique de cette Amérique qui doit s’agrandir en même temps qu’elle se recentre. Les deux processus vont de pair : les États-Unis se retirent du monde mais se concentrent sur leur environnement « naturel » (au sens géographique).
Ce mouvement marque un retour au XIXe siècle qui reste l’impensé américain. Le président Monroe déclara en 1823 que toute intervention européenne dans les affaires américaines sera perçue comme une menace pour la sécurité et la paix ; en contrepartie, les États-Unis n’interviendront pas dans les affaires européennes. Le fameux « isolationnisme » américain est en fait un séparatisme, conséquence logique de l’indépendance. Le séparatisme va dans les deux sens : ne venez pas chez moi, je n‘irai pas chez vous. La doctrine Monroe est mise en pratique à la fin du siècle par W. McKinley, régulièrement cité par D. Trump comme un exemple. Il interprète en effet la doctrine Monroe dans les atterrages américains, en provocant la guerre hispano-américaine de 1898 pour prendre le contrôle de Cuba (mais aussi Porto-Rico, Guam et les Philippines) tandis qu’Hawaï devient un territoire américain : l’intérêt américain pour l’océan Pacifique se manifeste alors.
Theodore Roosevelt lui succède et intervient dans les crises d’Amérique latine : Venezuela, Panama (concession du canal), Colombie. Il ajoute la doctrine du big stick qui donne aux États-Unis le rôle de gendarme du continent américain, complétée par le corollaire Roosevelt qui abandonne la neutralité inhérente à la doctrine Monroe.
Telle est la politique extérieure classique à laquelle Trump se réfère. Il veut ainsi mettre fin à la parenthèse expansionniste, initiée au XXe siècle par W. Wilson et poursuivie par Franklin Roosevelt et ses successeurs à l’issue de la 2nde Guerre mondiale.
Selon D. Trump, l’Amérique reste le lieu de la Destinée manifeste, croyance messianique en une prédestination américaine. Mais celle-ci doit se constituer sur le seul sol américain et non plus se diffuser au reste du monde. L’Amérique doit être élue mais séparée, selon le dessein des Pères pèlerins. Le Again du slogan MAGA se réfère donc à ce monde disparu du XIXe siècle.
Le ciblage de la Chine et de l’Europe
D. Trump rejoint ici le dernier consensus américain, celui qui consiste à considérer la Chine comme l’unique rivale à sa mesure. Sur l’objectif, il rejoint ce qu’affirmaient déjà les Démocrates et les néo-conservateurs mais s’en distingue par la méthode.
Il n’a ainsi pas commencé par cibler les Chinois mais a entamé un détour par les marges de la masse eurasiatique. Comme nous l’avons exposé régulièrement, D. Trump cherche d’abord à « renouer avec la Russie pour la séparer de la Chine. Cela consiste à renouveler le pari de Kissinger en 1972 qui avait organisé le rapprochement avec Pékin pour séparer la Chine de l’URSS » (LV 260). Il semble que cela aille au-delà et que le président américain envisage une réelle alliance commerciale avec le Kremlin : il est intéressé par les matières premières de la Russie et son rivage arctique, mais aussi son influence au Proche-Orient. Dans la région, il fait pression sur l’Iran (LV 263) avec l’aide de Moscou pour entamer une négociation avec Téhéran.
Quant à l’Europe, elle paiera. L’écroulement de son équilibre stratégique la présente divisée. Pour la quasi-totalité des Européens, la question stratégique première demeure la préservation du lien transatlantique, beaucoup plus importante que l’autonomie stratégique européenne, sans même parler du sort de l’Ukraine. Les uns et les autres vont ainsi se présenter en ordre disperser à Washington. Chacun a compris que la prime d’assurance venait de doubler. Les discours sur l’augmentation des dépenses de défense prennent prétexte de la menace russe pour justifier l’achat de plus d’armes, qui seront américaines, n’en doutez pas. Le sommet de l’Alliance à La Haye en juin le dira.
Casser la mondialisation financière
Le cycle de la mondialisation initié depuis les années 1980 par R. Reagan touche à sa fin. Nous sommes ici victimes d’une erreur de perception en croyant que la mondialisation fut conduite au seul profit des Américains. Or, elle ne désigne pas simplement l’augmentation des échanges de biens mais aussi des mécanismes financiers permettant d’optimiser les transactions, au travers de havres défiscalisés comme l’Irlande.
D. Trump veut donc démonter le système ce qui devrait réjouir les néo-marxistes, si prompts à dénoncer le capitalisme financier (on ne les entend guère). L’augmentation des droits de douane vise ainsi à : augmenter les impôts sur les importations, donc réduire le double déficit (celui du budget et celui de la balance extérieure) ; à abaisser la valeur du dollar, monnaie de réserve mondiale qui rend mécaniquement difficile l’exportation de biens américains ; si possible à affecter la mécanique des taux longs. Pour cela il a décidé d’augmenter les droits de douane de façon indiscriminée.
La Chine demeure la cible principale, comme l’illustre l’affaire des droits de douane qui n’ont cessé d’augmenter réciproquement, au cours d’une folle semaine.
La violence des réactions (vente des obligations américaines par les Japonais et les Chinois) a forcé D. Trump à revenir en arrière : aujourd’hui, seuls les taxes sont maintenues avec les Chinois.
Avoir une stratégie ne signifie pas qu’on sait la conduire avec habileté et mesure, deux qualificatifs qu’on peine à accoler au président américain qui a frappé trop fort.
Et maintenant ?
Malgré tout, les négociations sont ouvertes et l’affaire est loin d’être terminée. Beaucoup iront à Washington négocier des accommodements qui seront chacun présentés comme de grandes victoires.
D. Trump s’inscrit dans un mouvement qui le dépasse. Comme le dit F. Lenglet, « depuis l’ère Obama, l’ex-superpuissance américaine évolue et envoie un message constant : nous nous retirons des affaires du monde » (ici). La grande confrontation avec la Chine est arrivée mais pour Pékin, la victoire n’est pas forcément assurée car son modèle économique est lui aussi faible : surinvestissement des capacités et faible consommation intérieure dans une démographie en berne.
Simultanément, Trump est en phase avec une aspiration fortement partagée par les peuples contre leurs élites, ceux qui préfèrent le somewhere à l’anywhere de la caste dominante. Si Trump risque beaucoup de choses (le soft power américain, le dollar comme monnaie internationale) c’est pour accélérer un mouvement centripète qui l’avait précédé. L’histoire n’est pas finie : en fait, elle vient seulement de commencer.
JOVPN
Pour lire l'autre aeticle du LV 264, Le blanc et le noir, cliquez ici.