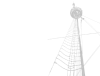Le blanc et le noir (LV 264)
Il est aisé, voire tentant, de réduire la complexité d'une réalité à un manichéisme simpliste. Pourtant, cette vision cache de dangereux écueils psychologiques esquissés ici. Mieux vaut un réalisme prudent et nuancé, indispensable pour un chef militaire et politique.
De manière simpliste, on résume la pensée manichéenne (à l’origine un courant religieux oriental complexe) à une dichotomie radicale entre le bien et le mal. Le « manichéisme » ne connaît pas la nuance et n’a en réalité plus rien de religieux. Pourtant, c’est une question brûlante d’actualité, en particulier dans ce qui était autrefois l’Occident (LV 146), comme nous aimons nous définir : une communauté de « valeurs », avec tout ce que cela a d’imprécis et de flou.
Dualité omniprésente
Dans la vie, il est aisé d’ordonner le monde de manière bipolaire, entre deux extrêmes d’une même réalité : il y a le bien et le mal ; une victoire et une défaite ; la gauche et la droite ; le blanc et le noir ; une bonne action et un péché ; le riche et le pauvre.
Positions trop tranchées
Cela cache trois écueils majeurs : premièrement, l’illusion (voire la tentation) de l’absolu, sans nuance, d’un côté comme de l’autre. On ne situe la réalité qu’à l’extrémité d’un spectre, sans apprécier les situations intermédiaires. Il est plus aisé d’appréhender une position claire, sans ambigüité, qu’une position qui comporte de l’incertitude. Le rejet et la fuite de l’incertitude est d’ailleurs une caractéristique – extrêmement dommageable – de la manière dont la dissuasion nucléaire est abordée de manière récente (LV 263).
En politique, ce schéma de pensée explique peut-être également le désaveu des électeurs des positions traditionnellement qualifiées comme « centristes », sous-entendu « modérées ». Le vote se fait plus clivant.
Des problèmes simples
Sans remettre en cause le « rasoir d’Ockham », qui consiste à vouloir écarter des explications trop compliquées d’un phénomène ou d’une action si des raisons plus simples peuvent être avancées, le deuxième écueil consiste à vouloir réduire la réalité à des positions « claires » peut conduire à simplifier à l’excès les raisonnements, dont le paroxysme est d’invoquer une raison unique pour expliquer des problématiques complexes.
Pour le formuler autrement, d’épineux sujets n’ont selon certains qu’une cause simple. En apparence. Pour changer le résultat, il suffirait de modifier une donnée d’entrée. Hélas, il s’agit d’un raisonnement très sectaire : on devient hermétique à des arguments ou des explications différents.
Là encore, observez ce qui se dit et ce qui s’écrit, surtout en politique : ce mode de pensée est pourtant de plus en plus répandu, et constitue un double mensonge. D’abord, les causes sont souvent multiples et surtout, lorsqu’on modifie l’unique donnée d’entrée, la pensée magique n’opère pas et le problème n’en est pas automatiquement résolu.
Prenons un simple exemple économique : il suffit de dépenser des milliards d’argent public dans l’économie pour augmenter la croissance, ce qui réglera automatiquement et mécaniquement tous nos problèmes (chômage, pauvreté, impôt, budget, développement etc.). Même si cela fait plusieurs décennies que ce schéma simpliste n’obtient pas les effets escomptés (en tout cas pas dans les dimensions espérées), c’est la seule recette économique que nos dirigeants politiques semblent connaître.
Emprisonnés par leur raisonnement, les victimes de la pensée unique récidivent encore et encore. On s’enfonce alors dans le mensonge pour éviter de devoir affronter la réalité et modifier sa vision : plutôt que de se demander sérieusement pourquoi la politique n’obtient pas les résultats escomptés, on décide que le déficit et la dette ne sont plus un problème, pour pouvoir dépenser toujours plus (et on l’explique le plus sérieusement du monde aux particuliers). Toute autre politique économique est taxée d’« austérité » et donc est frappée d’anathème : quelle horreur !
Amalgames inconscients dangereux
Le troisième écueil d’une vision bipolaire des choses de ce monde est peut-être encore plus pernicieux, il tient à l’amalgame inconscient de certains concepts qui n’ont pourtant rien à voir. Si A est contraire à B et que C s’oppose à D, c’est un syllogisme dangereux que de rendre équivalents et synonymes A et C d’un côté, B et D de l’autre. Et pourtant, cela se passe souvent. On associe toutes sortes de choses au camp du « bien » et inversement d’autres au camp du « mal ». Quelle tentation, c’est si facile…
Sans parler du fait qu’il est si agréable intellectuellement de faire partie du « bon camp », l’expression anglaise a des accents tactiques militaires : « the moral high ground ». L’archétype de cette pensée est la vision répandue actuellement de la Seconde guerre mondiale : le conflit opposait les démocraties contre le nazisme ; la liberté contre l’oppression ; les juifs contre les fachistes ; les résistants contre les collaborateurs. Les gentils contre les méchants, en somme.
Ces amalgames sont tout-à-fait simplistes voire dangereux et en tout cas anachroniques. Ils ne laissent aucune place pour une historiographie dépassionnée et analytique. Par ailleurs, peut-on encore parler d’une guerre – tout simplement existentielle – contre des envahisseurs et des occupants, où l’idéologie peut parfois jouer un rôle secondaire ?
Une fois que l’on a atteint ce stade de pensée simpliste, on met les autres positions dans un même sac et on prend un dénominateur commun extrêmement péjoratif et connoté pour désigner l’ensemble. Ce procédé est omniprésent dans nos débats publics.
Au fond, ce mode de pensée également nous rend à la fois perplexes devant les affaires du monde et nostalgiques du « bon vieux temps de la Guerre froide » où tout était si simple : les gentils gagnent à la fin, le camp occidental a gagné, donc l’Ouest était le camp du bien. En face, l’hydre soviétique et le bloc de l’Est sont hideux. Nous nous efforçons de diaboliser aujourd’hui les adversaires, en dépit du réalisme et du bon sens, afin de simplifier les données du problème et surtout afin de pouvoir nous complaire intellectuellement de résider dans ce camp du bien.
Dès que la réalité nous dépasse, nous sommes stupéfaits, puis rejetons le tout en bloc : comment est-ce que Soljenitsyne, ce résistant opprimé et pourtant Prix Nobel, a bien pu admirer la « Grande Russie » ? Comment est-ce qu’Aung San Suu Kyi, cette résistante opprimée et pourtant Prix Nobel, a bien pu être inflexible face au sort de la minorité Rohingya en Birmanie ?
Les exemples de ces complexités incomprises sont innombrables.
Qu’est-ce qui est bien ?
Cette question – en apparence si simple – est bien l’épineux problème, car la réponse n’est pas du tout évidente. C’est bien pour cela que notre esprit cherche à simplifier la donne pour nous amener à un point où l’on pourrait aisément décider entre un bien et un mal.
Or, le bien n’est pas uniquement l’opposé du mal. Ce n’est pas l’absence de mal non plus. Le bien est souvent relatif : il est différent selon les personnes et les situations. Ce qui est bien pour moi n’est pas nécessairement bien pour les autres. Ce qui nous apparaît comme étant bien est parfois ce que nous voulons qui soit bien, il y a une tentation psychologique inconsciente là-dessous.
Douloureux dilemmes moraux
Bien souvent, un décideur est confronté entre deux maux et on va tenter de choisir « le moindre mal », ce qui engendre bon nombre de dilemmes moraux qui peuvent provoquer une véritable souffrance psychologique. Face aux contradictions et face au mal, les règles générales ne suffisent plus, on s’intéresse aux cas particuliers, c’est la « casuistique ».
Un exemple : si dans ma religion, le suicide est formellement interdit, ai-je tout-de-même le droit de me suicider si je suis prisonnier et que je sais qu’on va me torturer afin de me soutirer des informations, tout en espérant être pardonné pour mon acte ? Autre exemple : est-ce justifié de sacrifier quelques vies si par cette action, on pourrait en sauver davantage ? À l’armée : est-ce que je peux ordonner à ces soldats de réaliser cette mission, alors que je sais qu’il y aura des morts ?
Parvenir à réconcilier son action avec des décisions qui allaient peut-être à l’encontre de ses valeurs (« moral compass » en anglais) pourrait être une des clés de résilience.
Les réponses à ce genre de dilemmes ne sont jamais simples et il y est impossible de choisir entre un bien ou un mal. Il n’est pas donné à tout le monde de porter le fardeau d’une telle décision, mais c’est précisément ce que l’on attend d’un chef.
C’est pourquoi il semble si important qu’un chef ait l’honnêteté intellectuelle pour apprécier toute la diversité des positions et des situations pour évaluer un problème, et de ne pas céder aux tentations psychologiques de la simplicité.
Dans les affaires militaires, il faut fuir l’absolu et revenir à un réalisme nuancé où l’on cherche l’avantage relatif sur l’adversaire, ce qui évite de tomber dans le piège inextricable de la victoire totale qui pousserait l’ennemi à capituler sans conditions et qui est une très mauvaise prémisse pour la paix.
Réfléchissons bien à nos propres positions et à nos propres buts stratégiques et faisons en sorte qu’ils soient réalistes et réalisables À défaut, nous nous condamnons nous-mêmes à la défaite (LV 233).
Parvenir à ce niveau de réflexion impose de se défaire des schémas de pensée blanc-noir. L’ennemi n’est pas le mal incarné, même si nous aimerions le croire pour justifier notre action.
JOVPN
Pour lire l'autre article du LV 264, La grande stratégie de Donald Trump, cliquez ici